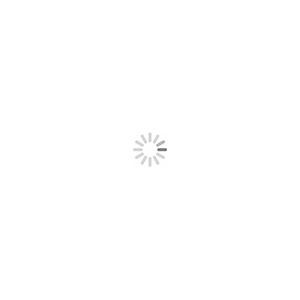Le Professeur Lazare Poamé a prononcé la conférence inaugurale intitulée « Bioéthique et Politique de développement en Afrique » lors de la rentrée doctorale de l’université de Lomé (Togo) le 6 novembre 2023. Ci-dessous, l’intégralité de son exposé liminaire.
Mesdames et Messieurs,
Nous voudrions exprimer, avant tout propos, tout le plaisir que nous éprouvons à nous retrouver, ce matin, dans cet autre temple du savoir qu’est l’Université de Lomé. Notre joie est d’autant plus grande que l’Université de Lomé et l’Université Alassane Ouattara de Côte d’Ivoire, que nous avons eu l’honneur de diriger en tant que Président, pendant plus d’une décennie, entretiennent d’excellents rapports de coopération depuis environ vingt ans à travers les Professeurs Christophe Dikénou, Nicoué Gahibor, feu Koffi Akibodé, Komla Nubukpo, Adama Kpodar et Dodzi Kokoroko.
C’est pourquoi, nous tenons à arrimer nos fraternelles salutations à des remerciements à l’endroit des autorités politiques et académiques du Togo pour ces longues années de coopération scientifique, mais aussi pour l’honneur qui nous a été fait à travers cette importante activité qui ouvre la rentrée académique doctorale. Nous aimerions remercier très chaleureusement le Président du Comité d’organisation et Directeur de l’École doctorale DEG, le Pr Akoété Agbodji, tous les Directeurs des Écoles doctorales, et le Pr Komi Kouvon, qui n’ont ménagé aucun effort pour rendre effective notre présence parmi vous. Nous remercions tout particulièrement le Président de l’Université hôte, le Pr Adama KPODAR que nous félicitons pour sa brillante nomination à la tête de cette Institution qui a connu de grands noms dont le dernier en date est le Professeur Komla Dodzi Kokoroko, actuel Ministre de l’Éducation nationale.
Nous ne saurions prononcer les premiers mots de cette conférence sans exprimer notre gratitude au premier Responsable de l’Enseignement supérieur et de la Recherche au Togo, le Ministre Ihou Wateba et à ses prédécesseurs, les Professeurs Komla Nubukpo et Octave Nicoué Broohm.
« BIOÉTHIQUE ET POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE »
INTRODUCTION
La Conférence inaugurale qu’il m’échoit de donner en présence de cette auguste assemblée est ainsi intitulée : « Bioéthique et politique de développement en Afrique ».
Que peuvent des mots de bioéthique contre les maux qui minent les politiques de développement en Afrique ?, serait-on en droit de s’interroger.
Pour lever toute équivoque et légitimer l’inscription de la thématique des politiques de développement dans le champ de la bioéthique, il est essentiel de clarifier ce que recouvre le vocable de « bioéthique » même si « définir la bioéthique est une entreprise périlleuse ».
En effet, « Son apparition récente, sa localisation interstitielle plus ou moins accentuée et les enjeux idéologiques qu’elle véhicule lui confèrent une identité instable et controversée».
Il y a certes une difficulté sur laquelle Hottois attire l’attention, mais cette difficulté ne doit pas devenir le prétexte pour renoncer à l’entreprise de dévoilement ou de saisie conceptuelle de la nature de la bioéthique.
Apparue dans les années 70 à travers les travaux de Van Rensselaer POTTER,
la bioéthique est, de prime abord, définie sur la base d’un recours naïf à l’étymologie qui en fait une éthique de la vie (bio-éthique). [Mais], cette approche simpliste nous donne de la bioéthique un sens trop vague. La bioéthique, de ce point de vue, embrasserait tout et rien de précis.
Une autre approche de la bioéthique est celle axée autour de la relation éthico-technique et qui met en avant les problèmes éthiques posés par le développement des technosciences biomédicales et biotechnologiques. Elle appelle une réflexion et des décisions concernant des domaines existentiels complexes et le conflit des valeurs.
Les thématiques majeures de la bioéthique peuvent être rangées sous sept (7) grands registres distincts, mais complémentaires : la procréatique, l’intervention dans le patrimoine génétique, l’intervention sur le vieillir et le mourir, l’intervention sur le corps humain, la manipulation de la personnalité et l’intervention sur le cerveau humain, l’expérimentation sur l’être humain, l’intervention sur les êtres vivants non humains. Ce dernier registre étroitement associé aux préoccupations liées au développement dit durable, appelle des réflexions sur la protection de tous les êtres susceptibles de souffrir, sur le droit à l’environnement et le droit de l’environnement, sur la brevetabilité du vivant, sur les plantes et aliments transgéniques bien connus sous le nom de OGM.
Aujourd’hui, selon E. et F. Hirsh, deux (bio)éthiciens de renom, la bioéthique « concerne désormais d’autres territoires que ceux délimités jusqu’à présent à la biomédecine dès lors qu’elle s’attache aux conditions de notre humanité dans son présent, son devenir, son environnement ainsi qu’à nos obligations universelles».
Le devenir des pays africains, mieux, les questions de développement de l’Afrique deviennent ainsi des problèmes de bioéthique, eu égard surtout au bilan négatif dressé par certains auteurs. « L’Afrique a la mauvaise réputation d’être une perpétuelle assistée et de donner l’image d’une mendiante, en dépit de ses nombreuses et immenses richesses » soutient Albert M’paka. Avec un
environnement en forte dégradation, mortalité et morbidité élevées, accroissement rapide de la population, production agricole en baisse ou largement inférieure à la croissance de la population, production technologique endogène relativement insignifiante, endettement asphyxiant, crise des finances publiques, etc… ,
tout porte à croire que les politiques de développement en Afrique restent marquées du sceau de l’échec.
Cependant, que l’on ne s’y trompe pas. Il ne s’agit pas de faire, ici, une description ou un diagnostic des politiques de développement en Afrique (le temps ne suffirait pas), mais d’inscrire la thématique de la politique de développement en Afrique dans le champ de la Bioéthique. Une telle posture a l’avantage de proposer un idéal de développement qui fait marcher de front le particulier et l’universel, la mésosphère politique et la macrosphère planétaire, le local et le global, l’endogène et son autre. Autrement dit, la question à laquelle nous espérons répondre est-celle-ci : Quelle politique de développement pour un développement éminemment durable en Afrique ?
Pour y arriver, nous nous proposons d’avoir recours d’abord aux deux paradigmes de développement que sont le paradigme néo-marxiste-léniniste et le paradigme des besoins essentiels.
Nous invoquerons ensuite un nouveau paradigme du développement, c’est-à-dire le développement dit durable. Ce paradigme nous servira de viatique pour penser les conditions d’une politique de développement en Afrique sur fond d’exigence bioéthique.
Nous allons donc commencer notre réflexion par une incursion dans l’histoire de ces paradigmes avec la réception africaine du paradigme néo-marxiste-léniniste du développement.
RAPPEL HISTORIQUE DE DEUX PARADIGMES DU DÉVELOPPEMENT
1.1 Le paradigme néo-marxiste-léniniste du développement et sa réception africaine
Marx et Lénine avaient une profonde aversion pour l’exploitation capitaliste, « une exploitation ouverte, éhontée, directe, aride ». Ils stigmatisaient l’impérialisme qu’ils considéraient comme le stade suprême du capitalisme et manifestaient une préférence ouverte pour le peuple des exploités, pour le développement des peuples appelés à s’affranchir de la domination impérialiste du capital.
Le paradigme néo-marxiste-léniniste a trouvé en Afrique ses théoriciens les plus illustres chez Nkrumah et surtout chez Senghor.
S’inspirant de la théorie marxiste-léniniste, Nkrumah et Senghor préconisèrent pour leurs peuples des modèles de développement qu’il est convenu d’appeler socialisme africain ou socialisme développementaliste.
Pour Nkrumah, les maux qui soulevaient l’indignation de Lénine (exploitation capitaliste, domination impérialiste du capital) étaient ceux qui frappaient de plein fouet le continent africain. Il croyait trouver dans le mot d’ordre lancé dans Le manifeste du parti communiste (Prolétaires de tous les pays, unissez-vous) le vecteur de son panafricanisme. Africa must unite, l’Afrique doit s’unir, l’homogénéité structurelle et idéologique du continent (africain) est une priorité. Plus : l’unité économique et politique du continent est un défi à relever au moyen des idées-forces du socialisme. Qu’on en juge par les propos de l’auteur :
Nous avons choisi le socialisme comme route du progrès […]. Mais plusieurs routes mènent au socialisme’’ notamment le consciencisme et le panafricanisme fondés sur l’unité des pays d’Afrique […] condition sine qua non d’un développement complet et rapide, non seulement de la totalité du continent, mais aussi de chaque pays.
Ainsi, affirme-t-il encore, pourrait
se créer une Afrique […] grande et puissante où les frontières territoriales qui nous restent de l’époque coloniale seraient désuètes et inutiles, et qui travaillerait à une mobilisation complète et totale de l’organisme de planification économique, sous une direction politique unifiée. […] Tel est le défi que la destinée a jeté aux dirigeants de l’Afrique.
Comme ces prolétaires de tous les pays appelés à développer une conscience de classe, les peuples africains doivent prendre conscience de leur situation d’exploités, de colonisés et d’aliénés. Par cette prise de conscience, les Africains constitueront une force homogène et éclairée, apte à les sortir ’’de la pauvreté, de l’ignorance et du désordre laissés par la colonisation’’.
Comment Nkrumah entend-il s’y prendre pour susciter une telle prise de conscience ? Son moyen est le consciencisme, cette philosophie de la praxis ainsi définie : L’ensemble, en termes intellectuels, de l’organisation des forces qui permettront à la société africaine d’assimiler les éléments occidentaux, musulmans et euro-chrétiens présents en Afrique et de les transformer de façon qu’ils s’insèrent dans la personnalité africaine.
Il s’agit, en clair, d’une disposition stratégique destinée à préparer la révolution des peuples africains à travers un socialisme universaliste devenu, par la force des choses (malgré certaines réserves du philosophe à l’égard du socialisme africain ambiant) un socialisme africain.
Le socialisme africain trouve chez Senghor des préoccupations développementalistes particulièrement expressives. Celles-ci ont été lumineusement présentées dans le texte de sa conférence donnée en 1975 à Tunis. Il s’y engageait à « discuter sérieusement, par-delà la libération politique de l’Afrique, du développement économique et social, partant culturel, de notre continent ».
Comme Nkrumah, Senghor se réclame du marxisme-léninisme qu’il se résout cependant à soumettre à une relecture africaine. Cette relecture lui offre l’occasion de discuter âprement la théorie marxiste-léniniste du développement uniforme. Contrairement aux fondateurs du socialisme scientifique, Senghor réfute la thèse marxiste du développement uniforme. D’après cette thèse, tous les peuples du monde, pour accéder au développement, se doivent de parcourir toutes les phases de la production capitaliste. Pour Senghor, la bourgeoisie et la dictature du prolétariat ne sont pas une condition préalable de la révolution sociale africaine.
Il pense, en effet, que « nous pouvons partir de la communauté primitive ou de l’étape la plus développée, de la communauté rurale pour arriver au socialisme en faisant l’économie de l’étape bourgeoise sinon de la lutte des classes ».
L’autre point du marxisme-léninisme soumis à une relecture africaine est le rapport superstructure / infrastructure. Examinant ce rapport, Senghor veut « en effet, […] savoir si, dans la réalité, la superstructure, c’est-à-dire les faits culturels, ne sont pas aussi agissants […] que les faits économiques ». Pour lui, la base économique du développement, bien que déterminante, doit, en ce qui concerne l’Afrique, subir l’influence de données aussi déterminantes telles la tradition, la religion et la langue. Pour peu qu’on y réfléchisse, on ne devrait pas hésiter à faire valoir dans les politiques de développement du continent cette position de Senghor.
Sous le double regard du marxisme et du socialisme africain, Senghor, commentant une idée de son conseiller économique, définit le développement comme « la satisfaction des besoins de l’homme : besoins animaux, dont la satisfaction permet de sortir de la faim et de la maladie, mais aussi besoins humains, qui ont pour noms instruction, mais surtout culture ». Nous amorçons ici un autre paradigme du développement, celui des besoins essentiels.
I.2. Le paradigme des besoins essentiels
Le postulat fondamental du paradigme des besoins essentiels est le suivant : le développement n’est pas possible sans la satisfaction des besoins essentiels. Dans cette perspective, Eppler, commentant Illich, relevait en substance que la seule réponse possible au sous-développement croissant du Tiers-Monde est la satisfaction de ses besoins essentiels.
Mais comment définir les besoins essentiels ? Comment juger de ce qui est essentiel pour l’homme, cet être qui ne vit pas que de pain ?
Des éléments de réponse sont repérables dans L’homme unidimensionnel d’Herbert Marcuse qui opère une nette distinction entre les vrais et les faux besoins. « Nous pouvons distinguer, écrit-il, de vrais et de faux besoins. Sont faux ceux que des intérêts sociaux particuliers imposent à l’individu : les besoins qui justifient un travail pénible, l’agressivité, la misère, l’injustice ». Les vrais besoins, en revanche, sont ceux dont la satisfaction garantit le plein épanouissement de l’homme. Au nombre de ces besoins, figurent en bonne place ceux que Marcuse qualifie de vitaux et que Marx appelle besoins radicaux, fondamentaux ; ce sont les besoins de nourriture, de logement, de vêtements et de quelques autres choses encore (noch einiges andere).
Sur ces quelques autres choses, Marx est malheureusement resté évasif, obnubilé qu’il était par l’histoire, mieux, par le matérialisme historique.
Pour le philosophe bioéthicien, ces autres choses sont à chercher dans la racine sémantique du mot essentiel. Est pour nous essentiel non pas simplement ce qui est indispensable, mais ce qui relève de l’essence, ce qui est conforme à l’essence. Des besoins ne peuvent être dits essentiels que s’ils sont conformes à l’essence axiologique de l’homme.
Les besoins essentiels sont donc, à proprement parler, ceux qui permettent de mener une vie authentiquement humaine. Plus que de simples besoins de l’homme, il s’agit de besoins humains proprement humains qui ont pour nom singulier Éducation. L’Éducation est le nom singulier d’une chose plurielle et comme telle, elle associe l’instruction et la culture. La dissociation de l’instruction et de la culture, dans les systèmes éducatifs de certains États africains, est l’un des effets pervers de la colonisation qui est en passe de trouver des solutions à travers la bioéthique et le nouveau programme de l’UNESCO visant à décoloniser l’enseignement de l’histoire de l’Afrique.
L’Éducation (instruction, culture) est donc ce qu’il y a de plus essentiel parmi les besoins dits essentiels de l’homme, car c’est elle qui confère au développement sa dimension véritablement humaine.
La prise en compte de cette dimension, reconnue depuis les années 60 par l’UNESCO, a abouti en 1992 à l’adoption, par le PNUD, du concept de développement humain. Ce concept, qui devrait donner au développement tout son sens, fut malheureusement « colonisé » par un modèle de développement de type stratégique : le développement durable. Fort heureusement, la bioéthique offre les outils intellectuels appropriés pour créer les conditions optimales d’une intellection critique des enjeux du développement (tout court) et du sens de la durabilité qui structure ce nouveau paradigme du développement.
II. LE NOUVEAU PARADIGME DU DÉVELOPPEMENT : LA DURABILITÉ
Parmi les spécifications du développement les plus connues, nous retiendrons, à titre heuristique, celles-ci : le développement économique, le développement technologique, le développement humain, le développement endogène et le développement durable.
Tout se passe en effet comme si, le développement, pour avoir du sens, doit être accompagné d’un qualificatif. Le sens d’un tel accompagnement ne va pas sans une interrogation sur le développement tout court.
Qu’est-ce donc que le développement ? C’est un mot-valise qui a marqué de son empreinte technoéconomique les sociétés contemporaines, réparties entre pays développés et pays sous-développés. De ce point de vue, le développement apparait comme un état qui caractérise le niveau de modernisation d’un État. Or, le développement, plus qu’un état, est un processus. C’est un mouvement continu de transformation technoéconomique et socioculturel d’un État qui devient synonyme de progrès. La prise de conscience de cette situation est à l’origine des expressions telles que pays en voie de développement ou en développement. Par la même occasion, le concept de développement endogène fut promu pour amener les pays africains à privilégier, dans les stratégies de développement, ’’ce que l’on a, ce que l’on est et ce que l’on veut devenir’’ selon J. Ki-Zerbo. C’est un développement fondé sur la valorisation du capital socioculturel local. Mais, devant le risque d’enfermement du développement dans le local, ce capital a été pris en compte à une échelle plus grande et mondiale à travers la notion de développement humain promue par le PNUD. Ainsi, sorti de ses orientations économocentrées et technicistes, le développement peut être défini comme un processus d’amélioration continu et multidimensionnel du système technoéconomique et du capital humain. Si cette conception du développement a l’avantage d’intégrer le social et l’humain, elle reste cependant anthropocentrique, donc partiellement soutenable parce que la composante écologique, environnementale lui fait défaut. D’où l’émergence du concept de sustainable development que les francophones ont tenté de traduire non sans difficulté par les expressions telles que ’’développement soutenable’’ ’’développement viable’’, ’’développement vivable’’ et ’’développement durable’’.
Le développement durable est la traduction officielle de l’expression sustainable development, suggérée par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement à travers le Rapport Brundtland. Ce Rapport, publié en 1987 sous le titre Notre avenir à tous, est devenu une référence mondiale.
Deux interrogations majeures méritent d’être esquissées : La première et la plus évidente invite à répondre à la question : qu’est-ce que le développement durable ? La seconde est une interrogation sur l’adjectif durable, une spécification sémantiquement chargée.
La définition du développement durable la plus officielle est celle issue du rapport Brundtland. Selon ce rapport, c’est ’’un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs’’.
Si la prise en compte des générations futures parait déterminante pour justifier le qualificatif ’’durable’’, la durabilité perçue sous cet angle pourrait prêter à confusion. Elle peut, en effet, renvoyer à la durée ou à un simple écoulement temporel intergénérationnel et faire perdre de vue la nécessité d’agréger harmonieusement des éléments divers, destinés à rendre le développement à la fois rationnel et raisonnable, donc logiquement et éthiquement soutenable. Il s’agit, au fond, d’intégrer, dans un même mouvement, les trois éléments que sont l’économique, le social et l’environnemental ou l’écologique. Les deux premiers (l’économique et le social) correspondent à ce que les anglo-saxons désignent par l’expression weak sustainability (soutenabilité faible / durabilité faible), caractérisée par une orientation anthropocentrique du développement. Le dernier élément, (l’environnemental ou l’écologique), qui est évidemment non anthropocentrique, nous fait entrer dans la catégorie du strong sustainability (soutenabilité forte / durabilité forte).
Le diptyque créé par la rencontre de l’anthropocentrique et de l’écocentrique a permis de concevoir de façon pluridimensionnelle les Objectifs du développement durable répertoriés comme suit :
Pas de pauvreté : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde.
Faim "zéro" : Assurer la sécurité alimentaire, une meilleure nutrition et promouvoir l’agriculture durable.
Bonne santé et bien-être : Garantir une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous à tous les âges.
Éducation de qualité : assurer l’accès à une éducation de qualité, équitable et inclusive, ainsi que des opportunités d’apprentissage tout au long de la vie.
Égalité entre les sexes : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles.
Eau propre et assainissement : Garantir la disponibilité et la gestion durable de l’eau et de l’assainissement pour tous.
Énergie propre et d’un coût abordable : Assurer l’accès à des sources d’énergie fiables, durables et modernes pour tous.
Travail décent et croissance économique : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous.
Industrie, innovation et infrastructure : Développer des infrastructures résilientes, promouvoir une industrialisation durable et encourager l’innovation.
Inégalités réduites : Réduire les inégalités au sein des pays et entre les pays.
Villes et communautés durables : Rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables.
Consommation et production responsables : assurer des modes de consommation et de production durables.
Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs impacts.
Vie aquatique : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines pour un développement durable.
Vie terrestre : Protéger, restaurer et promouvoir l’utilisation durable des écosystèmes terrestres, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, arrêter et inverser la dégradation des terres, et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité.
Paix, justice et institutions efficaces : Promouvoir l’accès à la justice pour tous et mettre en place des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.
Partenariats pour la réalisation des objectifs : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser.
Dans ces objectifs, s’entremêlent le vivable et le viable, le fiable et le soutenable, le rationnel et le raisonnable, la conscience anthropocentrique et la conscience écologique. Tout cela constitue l’arkhè de la bioéthique dite environnementale, repérable dans ce qu’il est convenu d’appeler avec F. Jahr ’’bioethischer Imperativ’’ (l’impératif bioéthique).
Notons qu’au cœur du développement durable, qui prend dans un même élan les activités des générations présentes ainsi que leurs effets sur les générations futures et la biosphère, se trouve la question de la responsabilité, sous ses formes multiples et diverses, individuelles et collectives, normatives, juridiques et surtout éthique, à savoir l’éthique de la responsabilité.
L’éthique de la responsabilité
Cette forme de responsabilité a été problématisée et promue en 1976 par le philosophe allemand Hans Jonas à travers un ouvrage publié sous le titre Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation. La pertinence du concept jonassien de responsabilité réside dans son ambition de supplanter ’’le principe ère classique de l’imputabilité causale’’ et d’aller au-delà du ’’calcul ex post facto de ce qui a été fait’’. En élevant la responsabilité au rang de principe singulièrement élevé de la nouvelle éthique requise pour garantir l’avenir de l’humanité et de la planète, Hans Jonas propose au monde le respect scrupuleux d’un impératif avec des formulations distinctes mais complémentaires :
« Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre» ou pour l’exprimer négativement
« Agis de de façon que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité future d’une telle vie » ; ou simplement « Ne compromets pas les conditions pour la survie indéfinie de l’humanité sur terre».
Le souci pour le futur et plus exactement pour les générations futures qui structure l’éthique jonassienne de la responsabilité connait une nouvelle fortune sous l’appellation de responsabilité intergénérationnelle ; celle-ci est considérée comme l’un des fondements les plus solides du développement durable. Par cette nouvelle forme de responsabilité, axée sur l’obligation que les générations présentes ont à l’égard des générations futures, un pas important est franchi pour restituer le sens de la notion de durabilité. Mais la durabilité doit aussi son sens à l’héritage du passé qui doit éclairer le présent dont dépend l’avenir. Par la prise en compte de cet héritage, la responsabilité intergénérationnelle fait place à la responsabilité transgénérationnelle qui combine l’expérience du passé, les préoccupations du présent et les obligations envers les générations futures. La responsabilité transgénérationnelle est donc cette série d’obligations, inspirées de l’héritage ou des leçons « ap-prises » avec les générations passées et dictées par le bien-être des êtres non encore présents au monde.
Avec certains auteurs (Hans Jonas, Gilbert Hottois et Jean-Pierre Séris pour ne citer que ceux-ci) et certaines institutions internationales spécialisées dans le domaine de l’éthique, en l’occurrence l’UNESCO, la question se pose de savoir s’il est ’’raisonnable de postuler une responsabilité pour des personnes qui n’existent pas encore ?’’.
Cette question est d’autant plus pertinente qu’elle met au jour l’une des problématiques bioéthiques, notamment celle du bien et plus précisément le principe de bienfaisance. Comment, en effet, décider de ce qui sera bien pour les générations futures, décider à l’avance et à la place des personnes à naitre, ce qui sera bien pour elles ? Notre responsabilité, celle des générations actuelles est de travailler à laisser aux générations futures un monde habitable par une humanité consciente de son universalité et de la nécessité de garantir de tout ce qui peut concourir à la préservation de l’espèce humaine.
Ainsi, toute politique de développement, aujourd’hui, devrait se donner comme une politique structurée par des exigences (bio)éthiques. Mais quelle est la nature de la bioéthique et comment arrive-t-elle à constituer le substratum d’une politique de développement ?
Il s’agit précisément de répondre à la préoccupation suivante : Comment s’opère le passage du communément durable à l’éminemment durable, c’est-à-dire comment polir le noyau rationnel de la durabilité inscrite au cœur du développement dit durable ?
III. UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SUR FOND D’EXIGENCE (BIO)ÉTHIQUE
III. 1. La nature de la bioéthique et le substrat d’une politique de développement
La bioéthique est
un ensemble de recherches, de discours et de pratiques généralement pluridisciplinaires et pluralistes, ayant pour objet de clarifier et, si possible de résoudre des questions à portée éthique suscitées par la R&D biomédicale et biotechnologique au sein des sociétés caractérisées à des degrés divers comme étant individualistes, multiculturelles et évolutives.
La nature de la bioéthique est fondamentalement repérable à travers ce qu’il convient d’appeler reliance épistémique éthico-pragmatique. C’est une colligation des différents types de savoir, effectuée in concreto et marquée par une accentuation de la responsabilité à l’égard du futur. Il s’agit, en effet, de relier par des cordons transphysiques (entrelacs de l’épistèmê et de l’éthos):
Le vivant humain et non humain ;
La réalité physique et le virtuel ;
Le champ constitutif des diverses connaissances, les sciences dites exactes et les sciences sociales et humaines;
Le relativisme et l’universalisme axiologiques ;
L’homo technologicus et l’homo ethicus ;
Les intérêts des générations présentes et des générations futures.
La bioéthique se pose ainsi comme un accompagnement critique et axiologique de l’évolution des technosciences biomédicales, biotechnologiques, et cognitives ou computationnelles au moyen d’une méthodologie foncièrement multi et transdisciplinaire qu’appelle la complexité des problèmes à résoudre. La bioéthique est un espace où :
La disciplinarité devient inter et transdisciplinarité ;
L’universel se particularise et le particulier s’universalise ;
Les théories éthiques et les expériences concrètes des individus ou groupes de personnes sont en interaction constante ;
Les deux rives du passé et du futur sont reliées par un pont.
La bioéthique est, somme toute, un savoir dont la nature est l’illustration la plus féconde de la complexité évoquée par Hottois qui décrivait, il y a plus d’une vingtaine d’années, la bioéthique comme « une école de la complexité ». Cette complexité que nous qualifions d’épistémo-éthicologique est également repérable dans le concept de développement dont les orientations stratégiques appellent un remodelage des savoirs enseignés. Le système LMD, dans lequel les pays africains sont entrés presque par effraction, a été institué en offrant principiellement aux universités la possibilité d’un réaménagement des disciplines classiques et d’une intégration de connaissances spécifiques. Avons-nous exploité à bon escient cette opportunité ? Plus ou moins. Avons-nous épuisé toutes les opportunités de réaménagement des connaissances aptes à sortir l’Afrique du sous-développement ? Assurément non. Nous en voulons pour preuve les savoirs endogènes laissés pour compte parce que considérés comme indigènes et indigestes. Sont également frappées d’une inflexion dépréciatrice, les valeurs archétypales qui liaient dans une même constellation respect de la nature et des personnes âgées, dépositaires pour la plupart d’un savoir socialement valorisé. Cela s’explique par une double préoccupation : disposer d’un capital humain apte à résoudre le problème de l’adéquation Formation – Emploi.
Pour l’éthicien ou le bioéthicien doté du troisième œil de l’homo éthicus, cette préoccupation est l’expression d’une ruse de la raison économique. De fait, dans le prétendu capital humain que l’on brandit parfois fièrement ou naïvement, l’humain dont il s’agit n’est autre que l’homo economicus, c’est l’humain formaté pour servir adéquatement le capitalisme marchand. Au fond, il s’agit de formuler des objectifs économiques en termes humains. On aboutit ainsi à une instrumentalisation insidieuse de l’homme qui devient un rouage du macrosystème économique.
Quant à la question de l’adéquation Formation-Emploi, le bioéthicien y voit l’expression d’une ablation de l’inventivité et de l’innovation sous différentes formes : incrémentale, disruptive et paradigmatique.
Les universités ne doivent pas se contenter d’offrir aux étudiants des savoirs sur mesure et encore moins des connaissances dont la consistance et l’utilité se mesurent à l’aune du marché de l’emploi. Ce marché, désormais soumis à un besoin d’éthique connu sous l’appellation de Business Ethics (éthique des affaires), doit être transformé et constamment redimensionné pour offrir davantage d’emplois et c’est à ce niveau que la bioéthique devient singulièrement opérante. Adossée à l’université, elle peut contribuer à former en cherchant à aller au-delà de l’existant, des emplois connus, étant donné sa nature prospective qui la rend propre à anticiper sur le pas encore. Par exemple, dans les domaines où intervient l’Intelligence artificielle, on peut envisager des offres de formation susceptibles de mettre sur le marché de l’emploi des spécialistes capables de réduire ou d’éviter les biais algorithmiques sur la base de connaissances inter et transdisciplinaires (informatique, philosophie, linguistique, droit, mathématiques, sociologie…).
Il s’agit, à présent, de s’interroger sur les méthodes de la bioéthique qui constituent des ressorts méthodologiques pour les politiques de développement.
III.2. Les méthodes de la bioéthique et les ressorts méthodologiques d’une politique de développement en Afrique
La méthode la plus ancienne et plus spécifique en bioéthique est le principisme. Traduit de l’anglais (Principlism), le principisme désigne l’approche méthodologique privilégiant le recours à des principes pour résoudre des dilemmes éthiques ou guider la prise de décision. L’approche principiste est l’autre nom de la méthode déductive (inspirée de la philosophie et des mathématiques) ou descendante (’’top-down’’). Par cette approche, le bioéthicien ou l’éthicien peut se targuer de résoudre la majeure partie des problèmes éthiques en leur appliquant les principes fondamentaux de la bioéthique que sont les principes d’autonomie ou de respect de la personne ; de non-malfaisance, de bienfaisance et de justice.
À l’opposé du principisme, la casuistique est présentée comme une méthode privilégiant les situations particulières, les cas individuels et concrets. Elle est décrite comme une méthode inductive, descendance ou ’’bottom-up’’, selon l’expression de Beauchamp et Childress.
Pour les bioéthiciens, nourris à la pensée dialectique, le principisme et la casuistique doivent être considérés comme les deux versants (descendant et ascendant) d’une réalité triadique. C’est ce que tente de montrer G. Durand lorsqu’il écrit :
La méthode scientifique adéquate en bioéthique est une sorte de méthode dialectique, d’autres diront herméneutique, où interviennent à la fois induction et déduction. On peut partir de valeurs, de principes, d’hypothèses et regarder les cas à travers eux, à la condition de comprendre le cas dans toute sa complexité et d’être toujours prêt à reconsidérer l’hypothèse, réinterpréter la valeur, le principe, changer la règle. On peut tout aussi bien partir du cas individuel, analysé selon toutes ses dimensions, en le confrontant ensuite aux valeurs, aux principes, à l’hypothèse.
Dans cette dialectique, le troisième élément de la triade est le cohérentisme tel que décrit par Beauchamp et Childress commentant Rawls. C’est la méthode de justification morale qui privilégie non pas la correspondance avec la réalité externe, mais la cohérence interne des ’’jugements bien pesés’’ ainsi que leur cohérence (externe) ’’avec les prémisses de nos engagements moraux les plus généraux’’.
Dans une perspective pédagogique spécifiée, montrant l’importance de la cohérence dans la réflexion (bio)éthique, l’UNESCO a présenté la méthode de raisonnement éthique comme outil de préparation de la bonne décision. Cette méthode comporte cinq étapes parmi lesquelles nous retiendrons les quatre premières.
La première est l’analyse minutieuse des faits à l’effet de se débarrasser des incertitudes et des idées factices.
La deuxième étape est l’identification, parmi les problèmes posés, du problème principal et des valeurs en jeu qu’il faut appréhender en termes de conflit de valeurs.
La troisième étape est celle de la discussion des devoirs sur fond de respect de toutes les valeurs en jeu en commençant par identifier les options qui constituent des extrêmes opposés. Les différentes valeurs en jeu doivent, par la suite, être jaugées les unes par rapport aux autres et permettre d’opérer le meilleur choix en situant l’accomplissement du devoir dans la voie moyenne, c’est-à-dire loin des extrêmes qui sont par définition anéthiques.
La quatrième étape, qui nous permet de renouer peu ou prou avec le cohérentisme, est consacrée à la vérification de la cohérence. Elle se préoccupe des incohérences qui pourraient entacher la réflexion ou la décision éthique et se propose de mettre ’’ à notre disposition un certain nombre de techniques pour nous prémunir contre ce manque de cohérence’’. Trois techniques sont identifiées parmi lesquelles deux nous paraissent les plus pertinentes :
Recourir à des critères externes de cohérence tels que le droit tout en sachant que des lois peuvent être injustes.
Se poser la question suivante : « me comporterais-je de cette façon si tout le monde savait que je me comporte de cette façon? » Ce à quoi il convient de répondre : « Il faut toujours choisir la conduite que nous souhaiterions voir ériger en règle universelle ». Ici, se pose le problème de l’universalisation des valeurs.
Ici, on est renvoyé au célèbre impératif catégorique kantien qui s’énonce : « Agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle». Cet impératif, miné par un solipsisme transcendantal, a été reformulé de façon dialogique par K.-O. Apel et J. Habermas pour en faire une procédure de l’argumentation morale propre à assurer la validité des normes d’action véritablement universalisables. Sa formulation est la suivante :
Chaque norme valide doit satisfaire à la condition selon laquelle les conséquences et les effets secondaires qui, de manière prévisible, résultent de son observation universelle dans l’intention de satisfaire les intérêts de tout un chacun peuvent être acceptés sans contrainte par toutes les personnes concernées.
Cette importance accordée à la méthode de l’argumentation morale a conduit à identifier le procéduralisme apelo-habermassien comme méthode de la bioéthique, applicable aux Comités d’éthique ou de bioéthique qui accordent une place prépondérante au processus délibératif et à l’impartialité des normes. Ce procéduralisme pourrait valablement s’appliquer à des Conseils Stratégiques de la Recherche, en l’occurrence le CSR créé en France par le décret n°2013 – 943 du21 octobre 2013. Composé d’experts nationaux et internationaux du monde socioéconomique et d’universitaires de renom, ce Conseil chargé de définir les grandes orientations de la recherche devrait garantir l’impartialité de ses décisions en les faisant passer au crible de l’éthique procédurale de la discussion.
Quels sont les principes qui structurent la bioéthique et quelles sont les orientations axiologiques du développement ?
III.3. Les principes de la bioéthique et les orientations axiologiques du développement
La bioéthique repose sur quatre grands principes devenus classiques après Beauchamp et Childress :
Autonomie (Consentement) ;
Non-malfaisance ;
Bienfaisance (bien médical / bien existentiel) ;
Justice (égalité / équité).
Produits dans les années 1970, ces quatre grands principes ont fortement influencé l’élaboration des principes du développement durable. Cette influence se perçoit mieux à travers les quinze principes de la bioéthique contenus dans la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme.
Ces principes, en raison des exigences formulées par les tenants de la casuistique, ont été affinés par l’UNESCO qui a fait passer de 4 à 15 le nombre de principes que compte la bioéthique. Ils partent de la Dignité humaine à la Protection de l’environnement, de la biosphère et de la biodiversité, en passant par les Effets bénéfiques et effets nocifs, l’Autonomie et responsabilité individuelle, le Consentement, le Respect de la vulnérabilité humaine et de l’intégrité personnelle, de la Vie privée et de la confidentialité, l’Égalité, justice et équité, la Non-discrimination et non-stigmatisation, le Respect de la diversité culturelle et du pluralisme, Solidarité et coopération, la Responsabilité sociale et santé, le Partage des bienfaits et la Protection des générations futures. Ces principes ont une affinité remarquable avec ceux du développement durable qui se présentent comme suit :
-Participation ;
- Protection du patrimoine culturel ;
-Préservation de la biodiversité ;
-Qualité de vie et des soins ;
-Responsabilité intergénérationnelle ;
-Solidarité ;
-Pollueur payeur ;
-Précaution.
Une politique de développement conçue à la lueur de ces principes et de ceux de la bioéthique affirmera avec plus de finesse et d’élégance les priorités telles que l’autonomie ou l’autodétermination, l’autoréflexion, l’autosuffisance, l’autoaccroissement des richesses nationales, le respect des valeurs socioculturelles, la protection des générations futures et de l’environnement.
CONSIDÉRATIONS FINALES
En définitive, l’application effective et efficiente des principes de bioéthique offre les garanties requises pour un développement éminemment durable et profitable aux Africains. Un développement qui est l’autre nom de ce que Joseph Ki-Zerbo avait appelé « le développement clés en tête ».
Cependant, la question fondamentale à laquelle les recherches sur le développement, aujourd’hui, devraient permettre de répondre est celle-ci : Comment tirer le meilleur profit du développement durable ?
La première condition nous semble être l’élaboration d’une politique impliquant un engagement sans feinte à faire passer la durabilité au crible de la méthodologie et de l’éthos propres à la bioéthique. Cet engagement peut être exemplifié à travers les activités d’un Conseil Stratégique de Recherche, subdivisées en quatre étapes :
Recueillir les besoins des populations et des décideurs exprimés de façon brute, naturelle, dialogale ou conversationnelle ;
Traduire ces besoins en objets de recherche pluri-inter et transdisciplinaire reflétant la nature épistémo-dialogique de la bioéthique ;
Transmettre aux décideurs les besoins ainsi transformés en objets de recherche ;
Rechercher avec les parties prenantes les moyens de satisfaire ces besoins exprimant des aspirations profondes au développement.
Pour rendre plus efficiente le traitement éthico-méthodologique des besoins exprimés par les populations, des formations spécifiques devront être organisées à leur intention. Il s’agit de les amener à s’approprier culturellement et linguistiquement les principes axiologiques de la bioéthique contenus dans la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme. C’est le sens du programme de la Chaire UNESCO de bioéthique dénommé « Semer les graines d’éthique dans l’esprit des populations ». Pour la mise en œuvre de ce programme de vulgarisation des principes et valeurs de la bioéthique en langues africaines, trois pays africains ont été identifiés : le Togo, le Burkina Faso et le Sénégal.
La bioéthique ayant pris naissance dans un espace socioculturel spécifique, c’est par des mécanismes d’appropriation culturelle de ses valeurs universalisables que l’Afrique affinera ses stratégies de développement.
Prof. Lazare Poamé,
Président du Comité Consultatif National de Bioéthique
Titulaire de la Chaire UNESCO de Bioéthique
Membre associé de l’Académie royale de Belgique
Président du Réseau Scientifique International Bioéthique et Développement (RSI B&D)